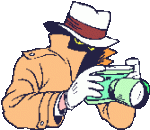Pour imaginer ce que peut devenir, ou non, la
FAMDT, il me semble qu’il faut comprendre ce qu’elle est maintenant. Et pour comprendre ce qu’elle est, connaître les grandes lignes de son histoire.
Sans vouloir jouer les anciennes combattantes, ou les veuves de guerre, je voudrais rappeler ici deux ou trois choses, à toutes fins utiles.
D’abord que la
FAMDT n’est pas issue directement du mouvement folk.
A la base du rassemblement que fut la FAMT, qui devint plus tard la
FAMDT, il y eut deux associations importantes de la fin des années 70 : l’UPCP (Poitou) et les Musiciens Routiniers (Limousin et Auvergne, principalement, et aussi Bourbonnais, Bresse et d’autres).
Ce qui caractérisait avant tout les fondateurs de ces associations, c’était leur polyvalence : chercheurs/collecteurs-musiciens –formateurs. Et ce qui les a légitimés, c’est le premier de ces trois volets : la recherche, la collecte - qui alimentait presque exclusivement leur musique - et les publications qui en ont permis la diffusion : 33 t., revues Plein-Jeu, puis Modal.
Le début des années 80 voit l’arrivée au pouvoir de la gauche qui nomme à la Direction de la Musique Maurice Fleuret, homme cultivé et passionné d’instruments de musique du monde, à une époque où ça n’est pas courant du tout. Il décide d’ouvrir le Ministère de la Culture à d’autres musiques que la musique classique, jusque-là exclusivement prise en compte. Pour gérer le bureau des musiques traditionnelles, il fait appel à un ethnomusicologue, Bernard Lortat-Jacob, qui connaît assez bien les travaux des jeunes (d’alors) ayant conduit les collectes que j’ai citées. C’est le début de deux processus parallèles d’institutionnalisation. On crée d’abord les conditions pour que les musiques traditionnelles puissent entrer dans les écoles de musiques, en organisant, en 1986, la préparation à un premier CA (1987) puis, ensuite, on commence de "labelliser" quelques associations importantes qui deviennent Centres en régions : AMTA, UPCP, Dastum, Conservatoire Occitan, Centre Lapios, MJC de Ris-Orangis.
À Bernard Lortat-Jacob succède un autre ethnomusicologue, Michel de Lannoy, et à Michel de Lannoy succède un troisième ethnomusicologue, Jean-Pierre Estival. Depuis quelques années, il n’y a plus de bureau des musiques traditionnelles à la Direction de la Musique, l’organisation générale en ayant été structurée différemment.
Le problème N°1 de la
FAMDT est, à mon humble avis, d’avoir plus ou moins abandonné, au fil des années, pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, le secteur "recherche". Elle a, en quelque sorte, scié en grande partie la branche sur laquelle elle était installée. Pas totalement, cependant, et c’est à la lumière de cette observation qu’on peut sans doute comprendre pourquoi C3c1l, se félicite sur Tradzone du soutien reçu, alors que Kalon se plaint du contraire.
Or je ne pense pas que "musique trad" ou "musique néotrad", si on les limite à de simples pratiques musicales, en situation de concert ou de bal, puissent revendiquer plus de reconnaissance que d’autres secteurs musicaux, comme celui des technivals, ou celui de la chanson française, entre multiples autres exemples, qui n’ont ni visibilité institutionnelle réelle, ni aide, à ma connaissance.
Le problème N°2 est, à mon humble avis toujours, le constat de "fuite des cerveaux" ou, plus simplement, de "fuite des acteurs" qui a marqué l’histoire de la
FAMDT, avec accélération nette ces dernières années. Et ce pour diverses raisons que je ne détaillerai pas davantage. Ce qu’on peut constater, en tout cas, c’est que les professionnels (intermittents, principalement) sont maintenant regroupés au sein du CPMDT (http://www.aemdt.fr), et que les professionnels de l’ethnomusicologie de la France sont en train de construire une association indépendante, suite au Colloque de Nice qui a également été évoqué sur Tradzone.
L’avenir de la
FAMDT me paraît donc assez obscur, quelle que soit sa gestion présente et future de la stratégie politique, qui a toujours été son point fort.