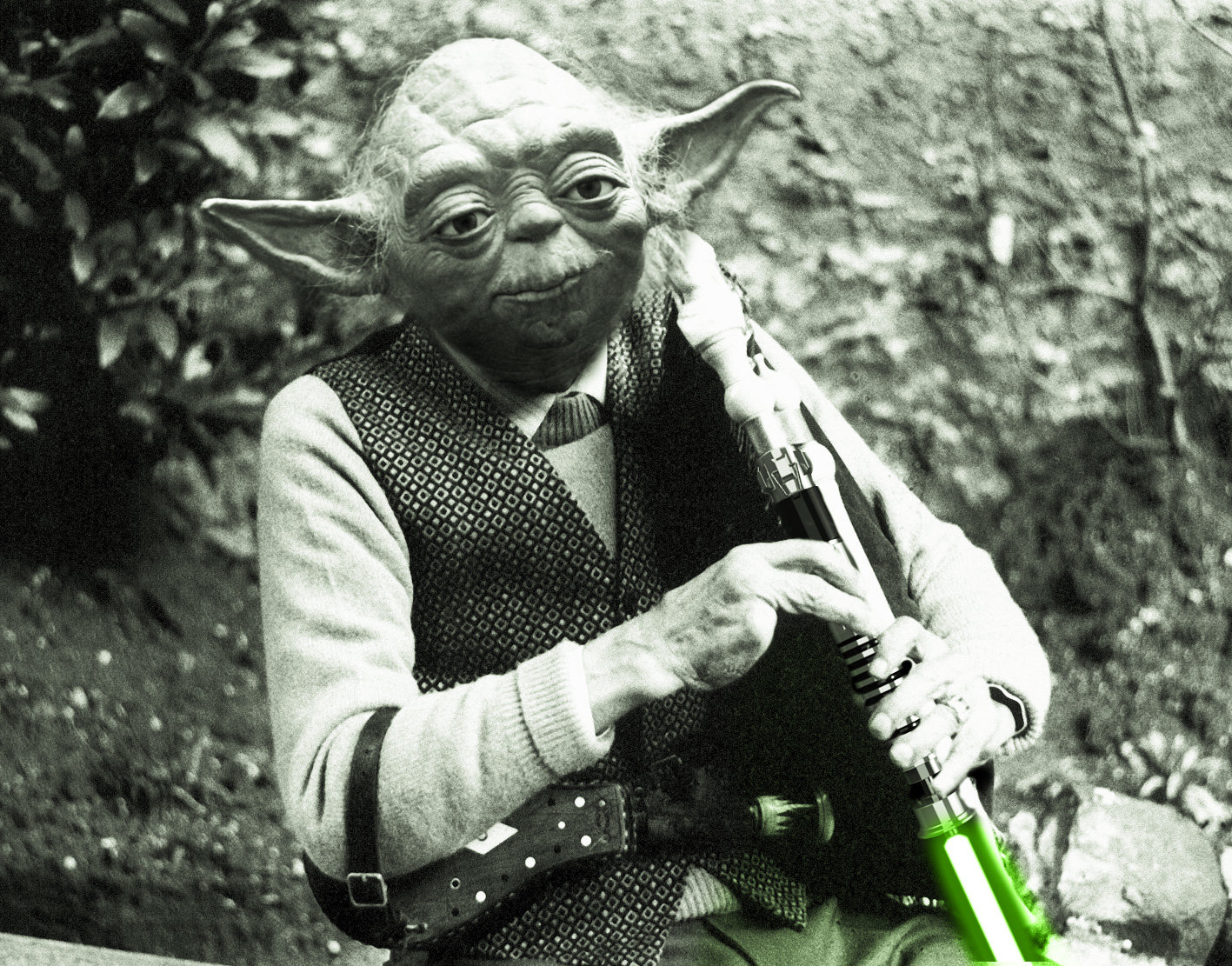Je reviens sur cette analyse:
Quant à l’esthétique de la musique, ici, elle est, pour moi, clairement et absolument berrichonne. Le tempo est lent (un peu trop peut-être, d'ailleurs ?), la dynamique particulière, bien marquée par le jeu de la vielleuse. Et pourquoi de chouettes bourrées du Limousin ou d’Auvergne ne pourraient-elles pas être chantées à la mode du Berry ? Surtout lorsqu’elles sont portées par des voix convaincues.
(...)
Avec le débat suscité par cette vidéo je sens , parce que c'est mon seul mode d'approche possible, que pour la musique il y a des choses non-dites, non formulées, ou peut-être alors identifiées seulement dans le cercle des musiciens qui sont "allés aux écoles"...
Qui a les compétences pour m'éclairer un peu ?
Question complexe. Il y a des interprétations qui peuvent être d’appartenance locale floue et d’autres qui sont sans ambiguïté. Certaines bourrées jouées par des violoneux corréziens ne seraient pas imaginables ailleurs. Même chose pour des bourrées de violoneux en Artense. Ce ne sont pas les mélodies qui sont particulières mais le style des musiciens. On trouve quelques pistes d’analyse là (mais il faut être sur Mac).
Dans le cas des Conteuses de pas, c’est sans doute effectivement le jeu de la vielleuse qui colore l’ensemble, donnant à tout ce passage une dynamique bien particulière – et là ça va être difficile d’expliquer ce ressenti par écrit – qui avance « droit devant », comme un petit rouleau compresseur puissant mais quand même léger. Une bonne interprétation de « bourrée des Monédières » devra, elle, de façon très différente, avancer de façon plus heurtée, et introduire, par exemple, pour varier, des rythmes pointés dans les mesures, des ruptures, des élans.
Histoire dans l’histoire : Quand j’ai entendu cette excellente vielleuse (d’accord avec AntoineL) je me suis demandé « Mais avec qui a-t-elle pu apprendre à jouer aussi bien ? ». A Bourges ? A Châteauroux ? Je n’avais pas encore repéré que le groupe était parisien. En tous cas ça faisait bien plaisir d’entendre ce jeu-là. Après est apparue la relation avec ce pseudo « Le tazon » et ça m’a rappelé de vieux souvenirs castelroussins. Pendant quelque temps j’avais, en effet, un peu harcelé Pierre Panis en lui demandant qu’on fasse ensemble un inventaire de ses collectes de danses en distinguant ce qu’il avait réellement observé de ce qu’il avait ensuite retransmis dans une perspective de chorégraphies destinées à la scène. Mais il n’avait pas du tout envie de s’atteler à cette tâche-là. Ce qu’il me demandait, c’était de lui faire des partitions de mélodies traditionnelles du Berry et lui, il les aurait dessinées avec son normographe, comme il l’avait fait pour sa petite publication « Douze danses populaires en Berry ». Nénette, sa femme avait fini par me dire « Il n’y a rien à faire, c’est un tazon ». C’était la première fois que j’entendais ce mot.
(...)
La langue d'Oc facilite grandement sur les bourrées (entre autres) car elle est plus percusive (je ne sais pas si cela se dit!) que le français et vient marquer les appuis de la danse il y a une osmose évidente entre les deux ( ...)
Je ne crois pas que l’occitan soit une langue plus percussive que le français. On a simplement plus l’habitude de l’entendre pour les bourrées. Mais le français me semble tout aussi propice aux appuis rythmiques, pour la danse, que l’occitan. Dans les documents de collecte, on entend souvent des musiciens chanter les mélodies qu’ils interprètent ensuite, ou avant. Quand Baptiste Porte chante « Le papillon suit la chandelle », Emile Gauthier « C’est un petit navire d’Espagne », Michel Meilhac « Aquesta nuech n’ai fach un songe » ou « La Mariçon totjorn credava » (ce sont toutes des chansons sur le timbre souvent connu avec les paroles « E quand las peras son maduras ») on a la même dynamique.
Ouiii bonne idée la flétrissure!
Je propose qu'on leur grave "chapelloise" dans le dos!!
En fait, j'avais pensé à "Néotrad" mais je me suis dit que ça pouvait peut-être en vexer certains, sait-on jamais, et le but c'est quand même qu'on soit tous copains.